1.Les
molécules :
1.1. Définition :
Une molécule est constituée
d’un assemblage d’atomes. Elle est électriquement neutre. Chaque molécule est
représentée par une formule brute qui traduit sa composition.
Exemples :
Molécule d’eau : H2O molécule de dioxyde de carbone : CO2 molécules de méthane : CH4
1.2. La liaison covalente :
·
Définition : Une liaison covalente entre deux atomes résulte de la mise
en commun de deux électrons de leurs couches externes pour former un doublet
d’électrons appelé doublet liant.
Les deux électrons mis en commun sont
localisés entre les deux atomes.
Chaque atome s’entoure des électrons
requis pour respecter la règle de l’octet ( ou du duet.)
·
Nombre de liaisons formés par un atome : le nombre de liaisons à former par un élément est égal au
nombre d’électrons manquants sur la couche externe de l’atome isolé pour obéir
à la règle de l’octet ou du duet.
Exemples :
L’atome d’hydrogène H(Z=1) : (K)1 , il doit acquérir un électron pour obtenir la structure
stable en duet. Il pourra former une liaison covalente.
L’atome d’oxygène O(Z=8) : (K)2(L)6, il doit acquérir deux électrons pour obtenir la structure
stable en octet. Il pourra former deux liaisons covalentes.
L’atome d’azote N(Z=7) : (K)2(L)5, il doit acquérir 3 électrons pour obtenir la structure
stable en octet. Il pourra former 3 liaisons covalentes.
L’atome de carbone C (Z=6) : (K)2(L)4, il doit acquérir 4 électrons pour obtenir la structure
stable en octet. Il pourra former 4 liaisons covalentes.
Fluor(1) et chlore(1)
·
Liaison covalente multiple :une liaison covalente multiple est constituée de deux ou trois liaisons
covalentes entre deux atomes.
1.3. Doublets non liants :
Un doublet non liant est formé de deux électrons de la couche externe qui ne sont pas engagés dans une liaison covalente. Ils n’appartiennent qu’à un seul atome.
2. La représentation de Lewis d’une molécule
2.1. Définition : Elle permet de représenter les doublets liants et non
liants d’une molécule. Les doublets liants se représentent par un trait entre
les symboles des atomes et les doublets non liants se représentent par un trait
à côté du symbole de cet atome.
2.2. Représentation de LEWIS de la molécule d’eau :
Méthode :
1. Ecrire la formule
brute de la
molécule.
2. Ecrire la
configuration électronique de chaque atome. En déduire le nombre ne d’électrons
externes des atomes
3. En déduire le nombre nL de liaisons covalentes que doit établir l’atome pour acquérir une structure en octet ou en duet.
4. Calculer le nombre
total nT d’électrons externes de la molécule. En déduire
le nombre nd de doublets
externes.
5. ![]() Répartir les doublets de la molécule en doublets liants(DL) et non liants(DNL)
en respectant les règles du duet et de l’octet :Représentation de Lewis de
la molécule.
Répartir les doublets de la molécule en doublets liants(DL) et non liants(DNL)
en respectant les règles du duet et de l’octet :Représentation de Lewis de
la molécule.
Exemple-1 :
Représentation de
LEWIS de la molécule d’eau
|
Formule brute de la molécule |
H2O |
|
|
Atomes |
H |
O |
|
Configuration électronique de chaque atome |
(K)1 |
(K)2(L)6 |
|
Nombre d’électrons externes |
1 |
6 |
|
Nombre de liaisons covalentes (DL) |
2-1=1 |
8-6=2 |
|
Nombre de doublets non liants(DNL) |
(1-1)/2=0 |
(6-2)/2=2 |
|
Nombre total des d’électrons externes de la molécule |
8 |
|
|
Représentation de LEWIS |
|
|
Exemple-2 : Représentation
de LEWIS de la molécule de dioxyde de carbone CO2
|
Formule brute de la molécule |
CO2 |
|
|
Atomes |
C |
O |
|
Configuration électronique de chaque atome |
(K)2(L)4 |
(K)2(L)6 |
|
Nombre d’électrons externes |
4 |
6 |
|
Nombre de liaisons covalentes (DL) |
8-4=4 |
8-6=2 |
|
Nombre de doublets non liants(DNL) |
(4-4)/2=0 |
(6-2)/2=2 |
|
Nombre total des d’électrons externes de la molécule |
16 |
|
|
Représentation de LEWIS |
|
|
3.Notion d’isomérie :
3.1. Formules
développées et semi-développées :
Dans une formule développée,
toutes les liaisons covalentes apparaissent.
Dans une liaison semi - développée, les liaisons concernant
les atomes d’hydrogène ne sont pas représentées.
Exemples : C3H8
Formules semi-développée: CH3 – CH2 – CH3
Formule développée:
3.2.Notion d’isomérie
Définition : Deux molécules sont des isomères si elles ont même formule
brute, mais des enchaînements d’atomes différents. Elles portent des noms
différents et ont des propriétés physiques et chimiques différentes.
Exemple-1 :
Dans le gaz naturel, on trouve en faible proportion deux isomères e formule brute C4H10 :
|
Butane |
Méthylpropane |
|
CH3 – CH2 – CH2 – CH3 |
|
Exemple-2 : 2
isomères correspondent à la formule brute C2H6O
|
Ethanol |
Diméthyloxyde |
|
CH3 – CH2 –
OH |
CH3 – O
– CH3 |
4.La géométrie des molécules :
4.1. Le modèle de Gillespie
:Répulsion des doublets
Dans le modèle de Gillespie, les doublets liants et non liants
se repoussent et s’orientent dans l’espace de façon à minimiser les répulsions.
Ils s’éloignent alors les uns des autres.
4.2. Représentation de Cram
:
Comme la représentation de Lewis n’indique rien sur la
géométrie de la molécule, Cram a conçu une représentation pouvant rendre compte
de cette géométrie .
Conventions :
Ø
Un
trait plein représente une liaison dans le plan.
Ø
Un
triangle allongé plein représente une liaison située en avant du plan.
Ø
Un
triangle allongé hachuré représente une liaison située en arrière du plan.
Ø
Exemples :
Représentation de Cram de la molécule de méthane CH4









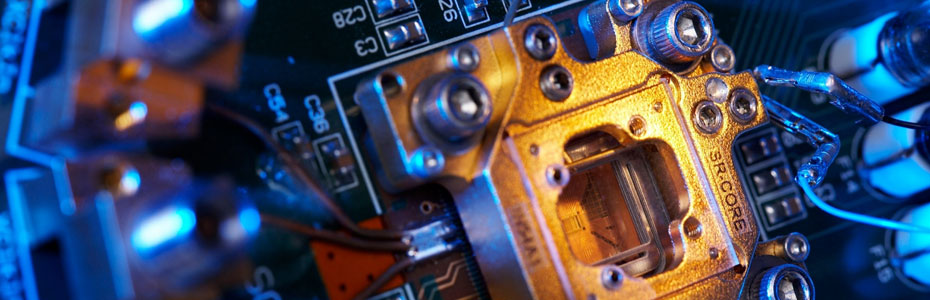


















.png)
.png)






_2.png)
























