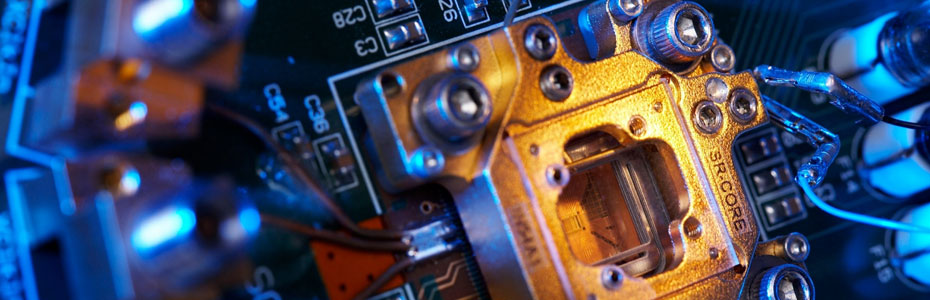Classification périodique
des éléments chimiques
Introduction : La Classification périodique des éléments est un outil
essentiel pour étudier les propriétés chimiques des éléments.Elle rassemble le
informations dont on a besoin pour chaque élément et de pévoir son comportement
dans des réactions chimiques.
1.La classification périodique des éléments.
1.1. La Classification de Mendeleïev
En 1869 Le
chimiste russe Dimitri Mendeleïev propose un tableau dans lequel les différents
éléments connus sont classés suivant leur masse mais aussi en fonction des
ressemblance entre leur propriétés chimiques.
|
H (1) |
?(8) |
? (22) |
Cu (63,4) |
Ag (108) |
Hg (200) |
|
|
Be (9,4) |
Mg (24) |
Zn (65,4) |
Cd (112) |
|
|
|
B (11) |
Al (27,4) |
? (68) |
Ur (116) |
Au (197 ?) |
|
|
C (12) |
Si (28) |
? (70) |
Sn (118) |
|
|
|
N (14) |
P (31) |
As (75) |
Sb (122) |
Bi (210 ?) |
|
|
O (16) |
S (32) |
Se (79,4) |
Te (128 ?) |
|
|
|
F (19) |
Cl (35,5) |
Br (80) |
I (127) |
|
|
Li (7) |
Na (23) |
K(39) |
Rb (85,4) |
Cs (133) |
Tl (204) |
|
|
|
Ca (40) |
Sr (87,6) |
Ba (137) |
Pb (207) |
Extrait du tableau de Mendeleïev.Les
masses atomiques sont indiqués entre parenthèse
Dans ce
tableau, trois éléments sont manquants car alors encore inconnus mais leurs
masses atomiques et leurs propriétés sont prévues et annoncées.Entre 1875 et
1886 le gallium, le scandium et le germanium sont découverts. Ils présentent
des propriétés très proches de celles prédites par D. Mendeleïev.
1.2. La Classification périodique actuelle
Le tableau
de Mendeleïev a servi de base à la construction du tabeau périodique actuel, et
qui commporte 118 éléments (Depuis la mise à jour de l'UIPAC* du 28 novembre 2016). Ces éléments sont rangés en 7
lignes et en18 colonnes, par leur numéro atomique Z croissant, de sorte
que les éléments d’une meme colonne possèdent le meme nombre d’électrons sur
leur couche externe.
* IUPAC :International Union of Pure
and Applied Chemistry: organisation
non gouvernementale ayant
son siège à Zurich, créée en 1919 qui s’intéresse aux progrès
en chimie, chimie physique, biochimie, etc.
C’est l’autorité reconnue pour le développement de règles à adopter pour la
nomenclature, les symboles et la terminologie des éléments chimiques et de
leurs dérivés, etc.
Classification simplifée des 18 premiers éléments :
|
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
|
1 |
H (Z=1) (K)1 |
|
|
|
|
|
|
He (Z=2) (K)2 |
|
2 |
Li (Z=3) (K)2(L)1 |
Be (Z=4) (K)2(L)2 |
B (Z=5) (K)2(L)3 |
C (Z=6) (K)2(L)4 |
N (Z=7) (K)2(L)5 |
O (Z=8) (K)2(L)6 |
F (Z=9) (K)2(L)7 |
Ne (Z=10) (K)2(L)8 |
|
3 |
Na (Z=11) (K)2(L)8(M1 |
Mg (Z=12) (K)2(L)8(M)2 |
Al (Z=13) (K)2(L)8(M)3 |
Si (Z=14) (K)2(L)8(M)4 |
P (Z=15) (K)2(L)8(M)5 |
S (Z=16) (K)2(L)8(M)6 |
Cl(Z=17) (K)2(L)8(M)7 |
Ar (Z=18) (K)2(L)8(M)1 |
formule électronique des atomes des éléments des trois premières lignes de la Classification périodique
2.Les familles d’éléments
2.1.La famille des alcalins : Ce sont les éléments de la première
colonne à l’exception de l’hydrogène.
Les trois
premiers alcalins sont : lithium Li, sodium Na, potassium K.
a.Quelques propriétés
chimique : ce sont des métaux mous,ils ne forment pas de
molécules.
Ils
réagissent epontanément avec le dioxygène de l’air pour former des composés
ioniques: Li2O , Na2O , K2O (oxydes de lithium, sodium et de
potassium)
le dihydrogène H2, des ions Li+, Na+,
K+ et d’ions hydroxydes HO-.
b.Inteprétation :Les atomes alcalins monoatomiques
isolés(X) ont un élecron externe.pour obéir à la régle du duet et de
l’octet,ils doivent predre cet électron pour former un ion (X+).Ils
ne forment pas de liasons covalents.
2.2.La famille des hologènes :Ce sont les éléments de la colonne
VII du tableau réduit.Les plus courants sont le fluor F, le chlore Cl, le brome
BR, l’iode I.
a.Quelques propriétés
chimique : Ils existent dans la nature sous
forme d’ions monoatomiques : F-, Cl-, Br-,
I-,.Ces ions forment des composées ioniques de formules NaCl, NaF..,
AgCl, AgBr.. .On les trouve aussi sous
forme de molécules diatomiques : F2, Cl2, Br2,
I2.
b.Inteprétation :
Les atomes
halogènes(X) isolés possèdent 7 électrons sur leurs couches externe.pour obéir
à la régle de l’octet,ils doivent gagner 1 électron pour former des ions (X-)
ou former 1 liaison covalente.
Remarque : un atome d’hlogène porte 3 doublets
non liants.
2.3.La famille des gaz nobles : Ce sont les éléments de la 8ème
colonne (du tableau réduit) : les 3 premiers sont l’hélium He, le néon Ne,
L’argon Ar. Ils sont plus stables et inertes chimiquement et ne forment pas
d’ions ou de molécules (sauf rares exceptions).
3.Utilisation de la classification périodique
Chaque
élément a des propriétés chimiques comparables à celle du premier élément de de
sa colonne.cette régle peut etre appliquée aux familles des alcalins
(colonneI)du bérylium (II), du carbone (XIV), de l’azote (XV), de l’oxygène
(XVI), des halogènes (XVII) et des gaz nobles (XVIII).
La charge
des ions et le nombre des liaisons covalentes formés par les éléments de
différentes familles.